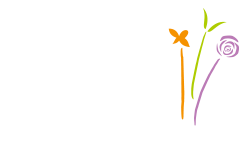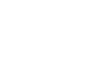ACCUEIL
MAIRIE
Votre mairie
Agence Postale communale
Le conseil municipal
Vie scolaire
Publications municipales
Urbanisme
Location salle des fêtes Meusnier Tulasne
Vie du village
Arrivee de la fibre
VIVRE
L'Ephémère : Boutique/Atelier
Festival de bouche et de blues
Gastronomie
Economie locale
Expositions et Artistes
A la Une
DÉCOUVRIR
Le fleurissement
Le jardin et la vigne du curé
Chédigny Jardin remarquable
Formations avec CLEOME
un village devenu jardin
La presse en parle
TOURISME
Promenades florales et patrimoniales
Randonnée pédestre et Vélo
Hébergement
plan du village
brochures
ASSOCIATIONS
|
Mairie de Chédigny |
02 47 92 51 43 NOUS ÉCRIRE COMMUNICATION Lundi - jeudi : 14h à 18h30 |
|